Les limites éthiques et légales de la science
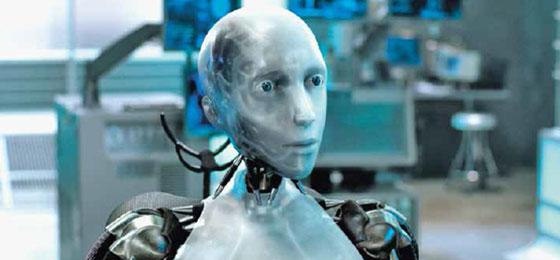
Les premières prescriptions légales sur la recherche clinique ont vu le jour suite à des expériences abusives sur l’être humain. Aujourd’hui, la science s’impose certaines limites, parfois même avant que le législateur n’en voie la nécessité. Par Ori Schipper
Nous devons une bonne partie de notre prospérité à notre soif de découverte, en particulier le doublement de notre espérance de vie au cours des cent dernières années. L’humanité serait-elle bien avisée si elle laissait libre cours à son envie d’apprendre sans baliser la science?
De nombreux abus rendent impossible un «oui» naïf. Ils ont d’ailleurs contribué, pas à pas, à l’élaboration d’un ensemble de règles toujours plus complexe qui impose aujourd’hui des limites, notamment à la recherche clinique. La plus ancienne ligne directrice éthique en matière de recherche remonte à 1900. Quelques années auparavant, un dermatologue, Albert Neisser, avait mené des essais sur des prostituées en leur inoculant la syphilis à leur insu. Le vif débat suscité par cet essai a donné lieu au «Code prussien sur l’expérimentation humaine». Il consigne pour la première fois l’obligation d’obtenir le consentement des sujets d’étude. En pondérant ainsi le droit du patient à disposer de lui-même, cette ligne directrice était en avance sur son temps, car le paternalisme de la relation médecin-patient n’a commencé que bien plus tard à voler en éclats, explique Sabrina Engel-Glatter, de l’Institut de bioéthique et d’éthique médicale de l’Université de Bâle.
C’est sans doute aussi pour cela que ce code n’a pas pu empêcher les essais sur l’être humain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans une lettre qu’il adresse à Heinrich Himmler, Sigmund Rascher, membre de la SS et médecin au camp de concentration de Dachau, déplore, par exemple, que «malheureusement, nous n’avons pas encore pu mettre sur pied d’études sur du matériel humain; ces essais sont en effet très dangereux et personne n’est prêt à y participer volontairement». Et Sigmund Rascher de demander à Himmler s’il ne pourrait pas lui mettre à disposition quelques criminels et détenus du camp pour ses expériences visant à étudier les chances de survie des pilotes après des sauts en parachute dans l’eau glacée de la Manche. Plus tard, Sigmund Rascher a demandé à être transféré à Auschwitz: le site était plus vaste et les essais pouvaient y être plus facilement menés, car les cobayes, «qui crient quand ils grelottent», y attiraient moins l’attention. Ses essais sur l’hypothermie ont coûté la vie à au moins 80 personnes.
Après la guerre, le procès intenté par les Etats-Unis contre les médecins responsables d’expérimentations sous le régime national-socialiste a entraîné la promulgation du «Code de Nuremberg». Ce document datant de 1947 définit en dix points qu’un consentement doit être obtenu sans pression ni tromperie, et qu’il peut être révoqué à tout moment. Le code exige aussi que l’essai produise des «résultats avantageux pour le bien de la société». Les principes exposés ont ensuite été affinés par l’Association médicale mondiale et intégrés dans la Déclaration d’Helsinki de 1964 qui, de façon plus détaillée que le code, prévoit notamment une protection spéciale pour certains groupes vulnérables (enfants, détenus ou personnes économiquement défavorisées).
Pression de l’opinion publique
Toutefois, ces réflexions n’ont été intégrées à la législation qu’après un autre scandale: la fameuse étude sur la syphilis de Tuskegee visant à étudier les conséquences à long terme de la maladie sur plusieurs centaines de travailleurs agricoles noirs. Le ministère américain de la santé avait démarré l’étude en 1932 et n’y a mis un terme que quarante ans plus tard, après qu’un informateur eut alerté les médias. La pression de l’opinion publique a finalement entraîné un arrêt rapide de l’essai. Persuadés que la qualité des données augmenterait avec la durée de ce dernier, les responsables de l’étude n’avaient jamais administré de traitement efficace aux participants alors que la pénicilline était disponible depuis la fin des années 1940.
En réaction à ce dérapage financé par des fonds publics, le Congrès américain a mandaté une commission nationale afin qu’elle formule les principes éthiques fondamentaux en fonction desquels la recherche sur l’être humain devait être conduite. En 1979, elle a formulé quatre principes dans le «Rapport Belmont»: autonomie du patient, assistance, justice et volonté de ne pas nuire. La même année a vu la parution de l’ouvrage «Principles of Biomedical Ethics» qui, pour la première fois, a permis une réflexion scientifique sur le sujet et servi de fondement à la bioéthique.
Depuis, des lois visant à renforcer les droits de patients ont été promulguées dans le monde entier, et des commissions d’éthique ont été mises en place dans la foulée. Avant même le début des travaux de recherche, ces dernières examinent si les sujets de l’étude sont suffisamment protégés, et si l’essai est défendable du point de vue éthique. «En Suisse, il existe aujourd’hui plusieurs commissions d’éthique, explique Sabrina Engel-Glatter. Elles peuvent poser des exigences et même refuser la conduite d’une étude.»
Des lois par anticipation
La recherche clinique n’a donc trouvé qu’au fil d’une histoire douloureuse les limites de ce qui est susceptible d’être éthiquement et juridiquement autorisé. Mais dans la recherche fondamentale, l’interaction entre science et législation suit aussi deux autres schémas. Il y a d’abord des lois «par anticipation» qui interdisent, par exemple, la création de chimères entre animal et être humain, ou encore le clonage humain. Elles sont promulguées avant même que la recherche ne soit en mesure de mener de tels essais. Ensuite, les scientifiques s’imposent certaines limites avant que le législateur n’en voie la nécessité. Le cas le plus célèbre est la conférence sur l’ADN recombinée, organisée par l’Académie américaine des sciences, qui s’est tenue en 1975 à Asilomar en Californie. Au début des années 1970, des chercheurs avaient modifié pour la première fois le génome de bactéries et de virus. Certains d’entre eux, comme Paul Berg, lauréat du prix Nobel de chimie, avaient alors réalisé qu’ils s’aventuraient sur un terrain délicat. Ils craignaient que des bactéries intestinales génétiquement modifiées puissent s’échapper par accident du laboratoire, infecter des individus et provoquer des cancers. Ils ont donc proclamé un moratoire en 1974.
L’objectif principal de la conférence d’Asilomar était de tirer au clair la question de savoir s’il fallait y mettre un terme, et le cas échéant dans quelles conditions, comme l’écrivait il y a quelques années Paul Berg, co-organisateur de la conférence, dans la revue Nature. Les chercheurs du monde entier auraient respecté ce moratoire. Toutefois, lors de la conférence, les opinions sur les risques auxquels on pouvait s’attendre divergeaient beaucoup. Paul Berg raconte avoir été frappé par un fait: de nombreux scientifiques considéraient leurs propres essais comme moins dangereux que ceux de leurs collègues.
Après des jours et des nuits de négociation, une percée s’est annoncée lorsqu’a été formulée l’idée d’une échelle du risque: un essai impliquant un agent pathogène doit être considéré comme fondamentalement plus dangereux que, notamment, un essai sur une souche bactérienne qui ne peut survivre qu’en laboratoire. La corporation rassemblée à Asilomar a ainsi posé les bases de certaines normes juridiques qui ont été introduites par la suite.
Paul Berg est persuadé que l’attitude prudente des scientifiques leur a permis de gagner la confiance du public. En procédant à l’une des premières applications du principe de précaution, la recherche – et l’industrie biotech – ont ainsi ouvert une voie. D’autres, comme Susan Wright, historienne des sciences, déplorent en revanche que la conférence ait essentiellement réuni des spécialistes de biologie moléculaire qui ont pu marquer le rapport final d’une empreinte réductionniste, fixée sur des solutions technologiques.
Génie génétique à l’école
Paul Berg admet que, par manque de temps, la conférence s’est surtout cantonnée à la sécurité dans le génie génétique. Toutefois, aujourd’hui, de tels essais ne se font pas seulement dans des laboratoires de haute sécurité, mais ont aussi lieu dans des écoles primaires. L’ironie veut que la crainte qui avait motivé la conférence d’Asilomar s’est largement dissipée, alors que les points de vue religieux et juridiques, mis entre parenthèses à l’époque, ont de plus en plus de poids. Dans les controverses actuelles sur les biotechnologies, il est souvent question de savoir dans quelle mesure des êtres vivants ou certains gènes peuvent être protégés par des brevets, ou encore s’il est légitime d’intervenir dans la Création.
De nos jours encore, certaines recherches font l’objet de moratoires. Dans son étude de cas, Sabrina Engel-Glatter se penche, par exemple, sur les essais de culture du virus de la grippe aviaire. Deux groupes de recherche – l’un aux Pays-Bas, l’autre aux Etats-Unis – ont voulu savoir s’il était possible de modifier ce virus de manière à ce qu’il ne soit pas seulement transmissible par contact avec des oiseaux, mais aussi directement d’être humain à être humain. Les scientifiques ont produit des virus qui se transmettent par voie aérienne de mammifère à mammifère. Et ont ainsi, pour reprendre les termes du directeur de la recherche, produit un virus «qui compte parmi les plus dangereux que l’on puisse créer». Lorsque les chercheurs ont voulu publier leurs résultats, il y a deux ans, cela a suscité de vives discussions. Devaient-ils garder leurs découvertes au moins partiellement secrètes afin d’éviter que les connaissances sur cet agent pathogène, à potentiel pandémique, ne tombent entre de mauvaises mains?
Les scientifiques ont décrété une pause volontaire de la recherche. Afin d’expliquer leurs travaux au reste du monde, ont-ils affirmé dans les revues Nature et Science, mais aussi pour laisser le temps aux organisations et aux gouvernements d’examiner leurs lignes directrices. Pour finir, les résultats ont été publiés, non censurés, pendant cette année de pause. Cependant, le débat sur l’utilité et les risques de ce genre de recherche est loin d’être clos, affirme Sabrina Engel-Glatter. «En Europe, dit-elle, il ne fait que commencer.»
Il y a quelques mois seulement, la Société européenne de virologie et le conseil d’éthique allemand se sont prononcés en faveur de l’instauration d’une commission de biosécurité. Sabrina Engel-Glatter estime que les organisations d’encouragement de la recherche devraient réfléchir elles aussi. Si c’est pour conclure que l’utilité d’un projet de recherche ne justifie pas ses risques, il est plus simple de ne pas le financer d’emblée, plutôt que de garder plus tard ses résultats sous clé, estime-t-elle.
Ori Schipper était rédacteur scientifique du FNS. Il travaille dorénavant pour la Ligue suisse contre le cancer.(De "Horizons" no 103, Décembre 2014)